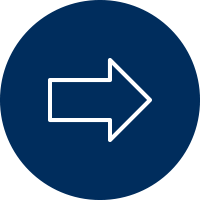La maladie d'Alzheimer
En quoi la maladie d'Alzheimer a-t-elle un impact aussi bien sur les mécanismes mnésiques que sur l'environnement du malade ?
Des examens plus approfondis (évaluation des fonctions exécutives )
Si les résultats des tests préliminaires jouent en faveur du diagnostic de la maladie d’Alzheimer chez le patient, alors le neuro-gériatre prescrit des examens plus poussés et plus spécifiques ; dans le cas inverse, la procédure d’établissement du diagnostic de la maladie d’Alzheimer s’arrête à ce stade.
Le patient est soumis à plusieurs examens permettant d'évaluer ses fonctions exécutives et d’établir son bilan neuropsychologique.
-
L’IRM (imagerie par résonance magnétique) permet de scanner le cerveau du patient, afin de mettre en évidence de potentielles lésions, à l’origine des symptômes du malade. Il est donc possible d’observer une atrophie du cerveau du malade (par rapport à la norme), caractéristique de la maladie d’Alzheimer : l’étude se concentre notamment sur l’atrophie hippocampique (l’hippocampe étant une région stratégique de la mémoire). Les IRM peuvent aussi montrer la présence d’anomalies cérébrales qui ne sont pas caractéristiques de la maladie d’Alzheimer. On citera par exemple les tumeurs ou les séquelles d’un traumatisme crânien. On dit dans ce cas que le diagnostic de la maladie d’Alzheimer est un diagnostic différentiel.
Dr Emilie Beaufils

Source: images fournies par le Dr Beaufils
-
Le liquide céphalo-rachidien (aussi appelé liquide cérébro-spinal) est le liquide dans lequel baigne le cerveau et la moelle épinière (ou moelle spinale) des êtres humains. Il est possible d'en réaliser l'analyse en effectuant une ponction lombaire dans le bas du dos du patient (entre la 4e et 5e vertèbre lombaire). En effet, cette analyse permet de doser la protéine TAU et la protéine béta-amyloïde, toutes deux présentes dans le liquide céphalo-rachidien et donc de conclure à d'une éventuelle mauvaise régulation de ces deux protéines caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Ce type d'analyse est systématiquement prescrit si le patient est jeune (- de 65 ans)
-
La scintigraphie est une technique d’imagerie médicale (du domaine de la médecine nucléaire), qui permet l’observation du fonctionnement et de l'activité d’un organe. Cette visualisation est réalisée grâce à une gamma-caméra qui détecte les radiations émises par un médicament radio-pharmaceutique (au préalable administré au patient), une fois fixé sur les organes que l’on veut observer. Dans le cadre de la confirmation d’un diagnostic de la maladie d’Alzheimer, la scintigraphie cérébrale permet de mettre en évidence de potentiels dysfonctionnements cérébraux. Sur le scintigramme ci-dessous, les zones les plus rouges sont les plus actives et fonctionnelles tandis que les zones vertes sont inactives et non fonctionnelles. On repère ici l'inactivité des zones temporo-pariétales (flèches) qui sont notamment les siège de la mémoire.(voir: Structures et mécanismes de la mémoire )

Scintigraphie cérébrale au HMPAO en faveur d'une maladie d'Alzheimer
Source: http://www.imnc-bordeaux.org/86-informations-sur-les-examens-complementaires-la-scintigraphie-cerebrale-au-hmpao.html

Source: http://www.imnc-bordeaux.org/86-informations-sur-les-examens-complementaires-la-scintigraphie-cerebrale-au-hmpao.html
Scintigraphie cérébrale au HMPAO d'un cerveau fonctionnel
Dr Emilie Beaufils
Si les différents tests ont permis de conclure que les symptômes présentés par le malade sont dus à la maladie d’Alzheimer, alors nous pourrons poser le diagnostic de la maladie.
Le diagnostic de la maladie reste néanmoins long et difficile à établir notamment à cause du caractère progressif des symptômes : en France, le diagnostic est en général établit 2 ans après l’apparition des premiers troubles. Il est d’autant plus difficile de diagnostiquer la maladie d’Alzheimer, qu’aujourd’hui on a encore du mal à distinguer clairement, ce qui est pathologique de ce qui est anodin, au début de la maladie.
Ainsi, au vue de la diversité des cas, et de par sa complexité, le diagnostic de la maladie d’Alzheimer requiert donc une véritable expertise de la part des équipes qui cherchent à l’établir. En effet, les neuro-gériatres (ou gérontologues) doivent être en mesure, grâce à leurs compétences et leurs connaissances de réaliser ou de prescrire au patient des examens appropriés permettant le diagnostic de la maladie, tout en tenant compte de l’unicité de chaque patient.
A SAVOIR
Il existe aussi des formes atypiques de la maladie d’Alzheimer : il arrive parfois que les troubles de la mémoire ne soient pas les premiers symptômes de la maladie.
Par exemple, lorsqu’une personne a des problèmes de vue, il arrive parfois que ceux-là ne soient pas occasionnés par un dysfonctionnement des yeux mais qu’il s’agisse plutôt d’un symptôme engendré par les lésions de la maladie d’Alzheimer. En effet, lorsque l’ophtalmologiste ne repère pas de problèmes notoires au niveau des yeux du patient, ce dernier est redirigé vers d’autres services médicaux, jusqu’à ce qu’il se retrouve dans un Centre Mémoire de Ressources et de Recherche. Une fois le malade pris en charge, la maladie d’Alzheimer peut être diagnostiquée. Les plaintes visuelles du patient sont être dues à un dysfonctionnement cérébral; le cerveau n’est plus à même d’analyser ce que les yeux voient : on parle d’agnosie visuelle (voir: les symptômes cognitifs)